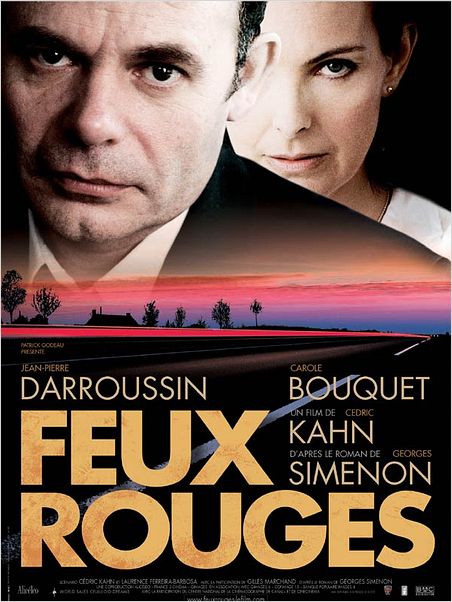Un couple, un
départ en week-end, un zeste d’alcool et les galères débutent. Feux Rouges s’esquisse comme une plongée
infernale, un cauchemar nocturne entre le déchirement d’une vie conjugale
abîmée par les fêlures du quotidien et l’errance d’un quadragénaire grisé par
l’alcool, entre un huis clos intimiste et un thriller aux frontières du
surnaturel. La force du film
tient à cette sinuosité de l’histoire qui embrasse plusieurs pistes avec le
même attrait, créant une fascination de la part du spectateur. Cette adaptation
d’un texte de Georges Simenon, publié en 1953, prend des libertés pour élaborer
un voyage à part, inscrit dans le territoire français, là où le récit original
se jouait aux Etats-Unis.
Au sein du
cycle « Les Couleurs de la Toile piquent leur crise », Feux Rouges constitue sans doute LE film
sur la crise du couple, où les rancœurs, les doutes, les reproches et les
suspicions fusent comme des coups de revolver. Le couple, incarné par Jean-Pierre
Darroussin et Carole Bouquet, affronte des remous dont il ne peut sortir
indemne. Pour figurer ce trouble, Cédric Kahn recourt à l’angoisse, à la
fois du récit policier et de la déambulation fantastique. Deux films sont ainsi à
l’œuvre dans Feux Rouges, dessinant
deux lectures plausibles de l’intrigue. La première partie du film suit la dispute et la dislocation progressive du couple, d’une
façon très classique, réussissant le tour de force de construire un huis clos
conjugal au cœur d’une voiture. Puis survient un chemin de traverse, le film
s’enfonce dans autre chose, prend le détour d’une voie davantage symbolique
pour poursuivre son exploration du couple. Car la quête d'un Jean-Pierre
Darroussin contraint d’avancer dans la nuit à la recherche de sa femme
soudainement et mystérieusement disparue peut se lire au premier degré - un
héros en proie à un adversaire qu’il doit déjouer (ici un évadé de prison) -
comme au sens purement figuratif - l’homme devant lutter contre lui-même et avec
ses démons s’il veut dépasser la crise conjugale.
Ce croisement
entre récit « réaliste » (si le mot signifie quelque chose, à savoir
ici une façon d’aborder des situations ordinaires, souvent dures, dans une
forme assez simple et proche des personnages) et embardées dans un cinéma dit de genre (policier, fantastique) constitue une des caractéristiques essentielles du cinéma de Cédric Kahn. L’Ennui, sorti en 1998, proposait certaines séquences déroutantes
proches de l’onirisme, Roberto Succo
(2001) ou Feux Rouges (2004) lorgnaient
sur le polar, L'Avion (2005) sur le
conte pour enfants, Une vie meilleure
(2012) occasionnellement vers le film noir. Mais le sujet à chaque fois
rattache les personnages à des réalités brutales du monde contemporain, qu’il
s’agisse de la dépression avec ses phases d’envolées lumineuses et ses effondrements
lugubres, de la crise conjugale, de la crise économique, du deuil ou de la folie.
Les thèmes tissent une cohérence dans les questionnements du cinéaste, mais la
forme évolue pour s’adapter au mieux à ce que le film raconte. Ces choix ne
sont pas dénués de risques et d’échecs. L’Avion,
injustement déprécié, devait pouvoir s’adresser au jeune public comme un
conte sur le deuil d’un enfant après la disparition d’un père. Il demeure un
passionnant film hors normes, aussi tendre que brutal. Cela suffit-il pour
approcher le cinéma de Cédric Khan ? Probablement pas, puisque d’autres
cinéastes jouent de cette ambivalence permise par la fiction entre un sujet
prenant ses racines dans des questionnements du quotidien et une forme lorgnant
vers d’autres horizons narratifs. Il ne s’agit pas ici de faire un tour
exhaustif des intérêts spécifiques du cinéma de Cédric Kahn, mais revenons tout
de même sur deux éléments assez récurrents dans son œuvre : le mouvement
et l’angoisse.
Cédric Kahn
est un cinéaste du mouvement. Cela ne passe pas forcément par des tours de
forces de mise en scène qui emploieraient des travellings interminables ou des
mouvements de caméra vertigineux. Chez Cédric Kahn, le mouvement s’inscrit à
nouveau dans l’agencement entre le fond et la forme. Roberto Succo suit la fuite en avant d’un tueur en série, d’une
façon originale, abrupte comme ses courses folles qui ne peuvent s’achever que
violemment. Feux Rouges continue
cette figure du mouvement, sur un rythme plus lent mais tout aussi nerveux. Une vie meilleure met son héros en
mouvement constant pour se dépêtrer de ses ennuis. L’Avion offre quelques scènes de poursuite et de vols. A chaque
fois, les personnages ne peuvent qu’avancer, qu’il s’agisse d’une fuite sans
retour ou d’un élan courageux pour ne pas se faire happer par les drames. A cet
égard, la fin d’une Vie meilleure se
conclut sur l’image du père et du fils roulant en motoneige dans les plaines
canadiennes, petite fenêtre d’espoir après la descente aux enfers autant que
signe d’une bravoure renouvelée, sur un chemin qu’il faut poursuivre coûte que
coûte. Dans Feux Rouges, après
l’errance nocturne, le couple se retrouve, se repose tout en ayant conscience
qu’il faudra continuer, la dernière séquence suivant leur voiture s’éloignait sur
une route de campagne.
L’angoisse est
un autre thème récurrent du cinéma de Cédric Kahn. Qu’il s’agisse d’une
angoisse violente ou sourde, elle s’immisce dans la plupart des films et
renforce la densité rythmique des récits : Les phases de dépression de
Martin dans L’Ennui, l’affolement
d’une bête pourchassée autant que la violence imprévisible du personnage dans Roberto Succo, l’inquiétude croissante
du mari dans Feux Rouges, les
craintes des personnages face aux situations parfois périlleuses de L'Avion, les hésitations du couple
adultère dans Les Regrets ou encore
la peur de l’effondrement dans Une vie
meilleure. L’angoisse protéiforme devient ainsi une figure marquante de nos
sociétés modernes comme une épée de Damoclès qui ne laisserait jamais les personnages
en paix. Même dans les phases de bonheur, l’ombre d’un malheur demeure
présente. Dans Feux Rouges, la
résolution finale conserve une part de noirceur. Dans Une vie meilleure, les retrouvailles finales donnent certes une
conclusion heureuse, mais la réalité sous-jacente demeure prégnante, la famille
a beau être réunie, rien n’est réglé, la fuite en avant se poursuit d’un
continent à l’autre et les protagonistes encore en liberté (le père et le fils)
ne peuvent se reposer. Le mouvement et l’angoisse offrent ainsi à Cédric Kahn
l’opportunité de varier la cadence de ses films, d’explorer plusieurs pistes et
d’entraîner ainsi le spectateur dans des récits captivants.
Feux Rouges réunit à merveille ces deux
grands aspects que sont le mouvement et l’angoisse. Cédric Kahn parvient à
transposer l’univers de Simenon tout en se l’appropriant, à parcourir diverses
ambiances narratives tout en gardant une cohérence et une œuvre accessible par
tous. [Spoiler] A l’inverse du roman, Cédric Kahn choisit de faire tuer le
prisonnier par le mari, au milieu des bois, comme un ultime sursaut de vie,
comme une vengeance inconsciente envers le criminel qui a violenté sa femme. Le
personnage de Jean-Pierre Darroussin devient ainsi tour à tour salaud ordinaire
par son alcoolisme dépressif, victime lâche, vengeur expurgatoire et amoureux
chevaleresque (voire la scène en voiture où il se rend à l’hôpital, filmé
autant comme une course hâtive pour se rendre au chevet de sa femme affaiblie
que comme la cavalcade d’un jeune amant vers son rendez-vous galant). Ce
croisement des genres pourrait laisser envisager, à un certain moment, que le
personnage de l’évadé ne soit que fantasmé, comme une représentation sauvage du
héros. Dès lors, l’histoire prend une vision différente. Le protagoniste ne
serait-il pas coupable de ce qui arrive à sa femme, n’aurait-il pas lui-même
violenté sa femme ? Le questionnement de la police, l’inspection de la
voiture de Jean-Pierre Darroussin, le regard fuyant et apeuré de Carole
Bouquet, sa femme, pourraient laisser envisager ce questionnement, confirmant
l’idée que le film n’est qu’une représentation hallucinée du déchirement du
couple, où l’homme, pris dans son plus noir dessein, serait un alcoolique
violent et perdrait tout contrôle de lui-même. [Spoiler] Cette même brutalité sous-jacente
d’un personnage au bord de l’explosion se retrouve dans d’autres films de
Cédric Kahn dont Une vie meilleure,
où Guillaume Canet devenait par moments inquiétant et violent.
A l’image de ses longs métrages,
Cédric Kahn demeure imprévisible, refusant d’être trop vite catalogué, évitant
l’esbroufe, variant les cadences, conservant une certaine simplicité et
sobriété tout en explorant des voies parfois périlleuses. A côté de la
réalisation, le cinéaste a fait quelques apparitions en tant qu’acteur, dont un
second rôle remarqué dans Alyah
d’Elie Wajeman et prochainement dans Tirez
la langue, mademoiselle d’Axelle Ropert. Difficile de savoir à quoi
ressemblera la suite de sa filmographie, mais espérons que ce cinéaste, discret
mais important, continuera l’exploration de thèmes personnels en recourant à
des formes déroutantes. En attendant, voir ou revoir Feux Rouges permet d’apprécier la valeur
d’un cinéaste qui pourrait encore surprendre à l’avenir.
Emeric
Bibliographie :
« Feux rouges est un
très bon film français grand public : des comédiens expérimentés et
exceptionnels (Darroussin et Bouquet sont des Stradivarius, rien moins), une
mise en scène qui sait ce qu’elle veut, un filmage limpide, rythmé, étranger à
tout naturalisme, un suspense intense, des dialogues géniaux (dont la plupart
sont de Simenon), une manière très réaliste de décrire la campagne française
d’aujourd’hui (avec ses ronds-points, ses éclairages modernes, ses parkings
flambant neufs et ses bars "à l’américaine"), et même des scènes hors
du commun (comme la longue suite de coups de téléphone donnés par Antoine pour
retrouver Hélène, le tout en un seul plan fixe).
(…)
Les scénaristes (Kahn, Laurence
Ferreira Barbosa et Gilles Marchand trois cinéastes) ont cru bon d’opérer un
bouleversement majeur dans le récit en y ajoutant un meurtre. Du coup,
l’attention du spectateur est un tantinet détournée du sens de l’œuvre d’ailleurs
assez opaque, qui tourne globalement autour des questions du couple, de la
folie, du bonheur.) »
Objectif Cinema, Marc Lepoivre
http://www.objectif-cinema.com/analyses/199.php
http://www.objectif-cinema.com/analyses/199.php
« Feux rouges confirme
magistralement une réalité du paysage cinématographique français actuel :
Cédric Kahn est le plus grand cinéaste français de l’angoisse. »
Telerama, entretien avec Jacques Morice
« Revoyez-vous vos films ? Pourquoi ?
Jamais volontairement. S’il
m’arrive de tomber par hasard dessus, à la télé, je regarde. Maximum vingt
minutes. Plus, c’est intenable.
J’ai plutôt l’impression d’avoir
raté des films entiers. Comme L’Avion. Un film
trop rugueux et bizarre pour être mainstream, pour viser le jeune et grand
public. Et en même tant trop produit, trop coûteux pour être un film d’auteur.
Le film ne fonctionne pas surtout à cause du gamin que j’ai choisi pour plaire
et émouvoir le public. Alors que j’aurai dû d’abord penser à mon désir... Cela
étant, aucun de mes films n’est totalement réussi. Tout film est perfectible à
l’infini."
Sur Gérard Depardieu comme acteur à
faire jouer : « Sans hésitation, Gérard Depardieu. Il est
toujours bien, parfois mieux que les films. C’est du cinéma à lui tout seul.
Dans Mammuth, il ne fait
quasiment plus rien, mais il est fantastique. Il est super émouvant. Il a
quelque chose qui manque au cinéma français, c’est la transversalité :
Depardieu est capable d’aller partout. Le cinéma français est assez cloisonné,
les gens ne se mélangent pas assez, les genres non plus. Lui n’a aucun problème
pour passer de Duras à Weber, de Pialat à Josée Dayan. Il est incomparable.
Pour Feux rouges,
je lui avais proposé le rôle. Il a hésité et, très cash, m’a dit « Trop de texte, trop d’alcool, trop de nuits.
Je n’ai pas assez d’énergie. » Je ne désespère pas de le
retrouver. »
Par
quoi vos films sont-ils obsédés ?
L’envie de vivre et la peur de mourir,
à moins que ce ne soit l’inverse. »